Quelle est la place du tuteur dans la vie intime, affective et sexuelle de la personne qu'il accompagne ?
La tutelle d’une personne majeure
La tutelle est une mesure de protection juridique des majeurs. Elle est prise par un juge, le juge des contentieux de la protection.
Le juge désigne une personne que l’on nomme le tuteur. Cette personne peut être un proche (époux, parent, concubin, ...) ou un professionnel appelé Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)*.
La tutelle peut être exercée par un tuteur ou par plusieurs.
Le but est de protéger et d’aider une personne majeure lorsqu’elle n'est plus en capacité de veiller sur certains de ses besoins.
Une mesure de protection judiciaire « a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci » (article 415 du Code civil).
Le tuteur peut donc aider la personne qu’il accompagne à :
gérer son argent et ses biens ;
prendre certaines décisions importantes ;
organiser son quotidien (mise en place d’une aide-ménagère, …).
Il existe 3 profils de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)* :
le mandataire salarié d’une association tutélaire ;
le mandataire individuel, qui travaille en tant qu’indépendant ;
le mandataire salarié dans un établissement sanitaire, social ou médico-social tel qu’un hôpital ou un EHPAD.
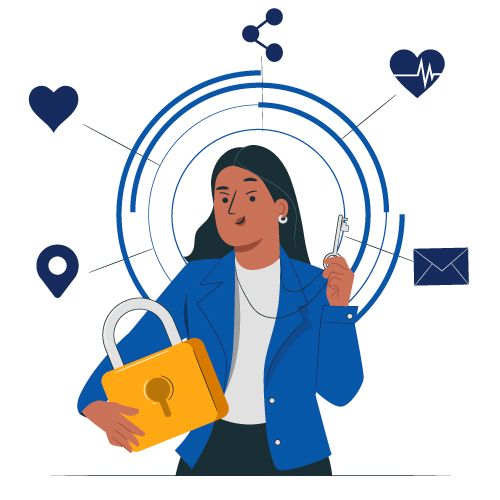
La place du tuteur dans la vie intime, affective et sexuelle
Le droit au respect de la vie privée
Le respect de la vie privée est un droit fondamental. C’est-à-dire un droit essentiel et universel que possède chaque être humain.
La mesure de tutelle “est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne” (article 415 du Code civil).
Les personnes sous tutelle ont donc le droit au respect de leur vie privée.
Ce droit fondamental implique le respect de l’intimité de chacun, mais également « le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables* ».
Ce droit est important car il sert de socle à d’autres droits, notamment les droits sexuels.
*Arrêt Niemietz c/ Allemagne rendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).
Par exemple, toute personne a le droit :
au respect de son corps ;
de décider s'il veut avoir une vie sexuelle active ou non ;
d'obtenir des informations sur la sexualité ;
d'accéder à la contraception et aux soins.
La place du tuteur
Toute personne est libre de vivre sa vie intime, affective et sexuelle comme il le souhaite, sous réserve du respect de la loi.
Une personne sous tutelle n’a aucune obligation de partager des informations à ce sujet avec son tuteur, sa famille, ou les professionnels qui l’accompagnent.
Par ailleurs, la personne sous tutelle peut prendre seule certaines décisions relatives à sa personne :
Elle entretient librement des relations personnelles avec les tiers (article 459-2 du Code civil).
Elle peut se marier ou se pacser sans l'autorisation du tuteur, mais il doit en avoir été informé préalablement (article 460 du Code civil).
Ainsi, même si le tuteur a un rôle de représentation de la personne, il doit garantir le respect des droits et libertés de la personne qu’il protège.
Il ne peut donc pas interdire une personne d’avoir des relations avec des tiers, ou encore l'empêcher de recevoir et d’accéder à des informations sur la sexualité, la contraception, …
Au regard de l’ensemble de ces éléments, priver une personne en situation de handicap d’une vie intime, affective et sexuelle peut être perçu comme une forme de violence.
La place du tuteur dans les soins
Quand le juge décide une tutelle à la personne, il peut choisir si le tuteur assiste ou représente cette personne dans les actes personnels. Selon cette décision, la place du tuteur ne sera pas la même. Dans les deux cas, la personne sous tutelle garde des droits.
Le droit à l’information
La personne sous tutelle a le droit d’être informée sur son état de santé.
Les informations doivent être transmises d'une manière adaptée à sa capacité de compréhension.
Si la mesure est assortie à une assistance à la personne, la personne concernée doit donner son accord pour que les informations médicales la concernant soient transmises au tuteur (article L1111-2 III° Code de la santé publique).
Si la mesure est assortie à une représentation à la personne, le tuteur est informé.

Le droit au consentement
Le consentement d'une personne sous tutelle doit être systématiquement recherché.
Lorsque la personne est en capacité d’exprimer sa volonté, son consentement doit être obtenu pour tout acte médical ou traitement. Elle peut donc refuser un soin de façon autonome.
Si la mesure est assortie à une assistance à la personne, la personne concernée autorise ou refuse l'acte. Le tuteur n'a pas le pouvoir de décider à sa place.
Si la mesure est assortie à une représentation à la personne, la place du tuteur dépend du discernement de la personne au moment de la prise de décision :
Si la personne est en capacité d'exprimer sa volonté, elle autorise ou refuse l'acte.
Si la personne n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté, le tuteur prend la décision, en tenant compte dans la mesure du possible de l'avis de la personne concernée (article L1111-4 VIII° du Code la santé publique).
En cas de désaccord ou de refus de soins
Sauf urgence, en cas de désaccord entre la personne protégée et le tuteur avec représentation à la personne, c'est le juge qui choisira qui doit prendre la décision.
Si la personne n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté, et qu’il y a un désaccord entre les professionnels qui l’accompagnent et son tuteur, il est possible de saisir le juge des contentieux de la protection par courrier.
Lorsque le tuteur avec représentation à la personne refuse un traitement, et que ce refus risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur protégé, un médecin peut délivrer les soins indispensables (article L1111-4 IX° du Code de la santé publique).
Par ailleurs, toute personne peut saisir les services du procureur de la République s’il estime être en présence de faits relevant de la loi pénale (maltraitance, violences, ...). Le fait par exemple de refuser des soins nécessaires à la santé de la personne peut être considéré comme une forme de maltraitance ou de négligence.
C’est le procureur de la République qui va qualifier les faits et envisager, ou non, une enquête et des poursuites pénales.
Cet article vous donne un aperçu général du rôle du tuteur.
Pour une compréhension complète et ajustée de chaque situation, il est important d’en discuter avec la personne en charge de la mesure de protection juridique et de se référer à la décision rendue par le juge.
Nous remercions les professionnelles de l’APASE pour leur contribution à la rédaction de cette réponse :
Ingrid VANECHOP, Cheffe de service Protection Juridique des Majeurs à l’APASE, antenne de Fougères
Christelle LE GOURRIEREC, Cheffe de service Protection Juridique des Majeurs à l’APASE, antenne de Rennes
Helena LE BARBIER, Chargée de mission à l’APASE
Pour aller plus loin
« Accompagner la personne nécessitant une mesure de protection juridique », Recommandation de bonnes pratiques professionnelles, Haute Autorité de Santé, 3 décembre 2024.
